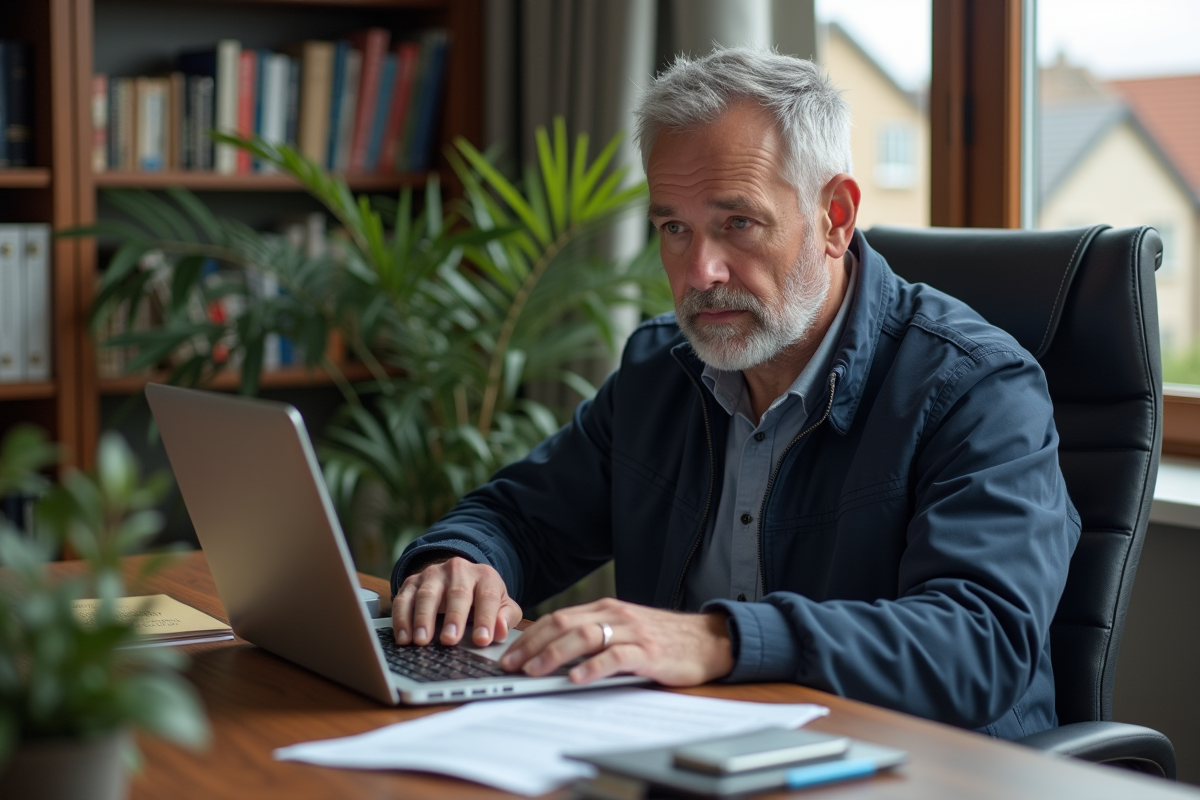Un salarié peut cumuler le forfait mobilités durables avec un abonnement de transport en commun, mais seulement si le total ne dépasse pas 800 euros par an. Selon le mode de déplacement choisi, l’employeur décide d’accorder ou non cette aide, sans obligation générale d’application dans le secteur privé.
L’administration fiscale considère cette indemnité comme exonérée d’impôt, sous réserve du respect des plafonds réglementaires. Les modalités de versement varient fortement selon l’entreprise et le statut du bénéficiaire.
Le forfait mobilités durables : une réponse concrète aux enjeux écologiques du quotidien
Le forfait mobilités durables ne se contente pas de jolis principes : il concrétise la loi d’orientation des mobilités adoptée en 2019, en encourageant salariés et employeurs à revoir la façon de se rendre au travail. Fini le tout-voiture, place aux moyens de transport alternatifs comme le vélo, le covoiturage, la marche, la trottinette électrique ou encore l’autopartage. Ce coup de pouce, entièrement facultatif dans le privé, marque un tournant dans la façon dont les entreprises abordent la mobilité de leurs équipes.
L’instauration de ce forfait trouve son sens à la croisée des chemins : d’un côté, les sociétés sont poussées à intégrer la RSE dans leur stratégie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux trajets domicile-travail devenant un enjeu de réputation et de cohérence. De l’autre, les salariés cherchent à sortir de l’impasse de la voiture individuelle, parfois par choix, parfois sous la pression du trafic et des règles environnementales.
Mis en place par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), le FMD va bien au-delà d’un simple bonus financier. Il impose la mobilité durable comme un sujet RH à part entière : plans de déplacement, dialogue avec les représentants du personnel, reconnaissance des pratiques responsables. Même limité à 600 euros par an, ce dispositif a déjà changé les habitudes dans de nombreuses entreprises.
Voici quelques retombées concrètes du forfait mobilités durables :
- Réduction des émissions : la part de la voiture individuelle recule, au profit de solutions partagées ou décarbonées.
- Effet entreprise : l’engagement environnemental devient palpable, l’image employeur gagne en attractivité.
- Pour le salarié : le passage à une mobilité responsable se fait sans sacrifier son pouvoir d’achat.
Le forfait mobilités durables s’inscrit ainsi dans cette série de mesures qui, sans tout bouleverser, accélèrent la transformation des pratiques. Sa montée en puissance s’appuie sur l’urgence climatique et l’évolution des attentes sociétales.
Qui peut bénéficier du dispositif et dans quelles conditions ?
Le forfait mobilités durables cible un large public. Dans le secteur privé, chaque salarié peut en bénéficier, à condition que son entreprise ait décidé de l’adopter. Ce n’est jamais automatique : tout dépend de la politique interne, discutée le plus souvent avec les représentants du personnel. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une politique de mobilité durable et de responsabilité sociétale.
Du côté du secteur public, les règles se précisent. Certaines administrations doivent accorder le forfait à leurs agents, en suivant des critères propres à chaque fonction publique, État, territoriale, hospitalière. Les établissements publics appliquent le dispositif avec des variantes selon leur organisation.
À noter : les auto-entrepreneurs sont exclus du périmètre. Le forfait ne leur est pas accessible, quel que soit le mode de transport employé.
En résumé, les grandes lignes d’attribution sont les suivantes :
- Facultatif pour le privé : la décision revient à l’employeur.
- Obligatoire dans certaines administrations publiques, avec des critères propres à chaque secteur.
- Exclusion pour les auto-entrepreneurs : dispositif non ouvert.
Pour toucher le FMD, il faut déclarer l’utilisation effective d’un mode de transport durable pour les trajets domicile-travail. L’entreprise peut réclamer une attestation sur l’honneur ou des justificatifs (tickets, factures, abonnements). Ce contrôle, loin d’être purement administratif, assoit la confiance mutuelle autour d’une mobilité responsable.
Montants, modes de transport et exonérations : ce qu’il faut savoir avant de se lancer
Le forfait mobilités durables s’inscrit dans la stratégie RSE et accompagne la transition écologique des entreprises. Dans le privé, l’aide atteint jusqu’à 600 euros par an et par salarié, et grimpe à 900 euros si elle est combinée à la prise en charge d’un abonnement de transport en commun. Pour la fonction publique, le plafond est de 300 euros par an, ajusté selon la fréquence d’usage d’un mode de transport éligible.
Le panel des modes de transport concernés est large : vélo personnel ou en libre-service, vélo à assistance électrique, covoiturage (en tant que conducteur ou passager), trottinette électrique, engins de déplacement personnel motorisés, autopartage avec véhicule électrique, transports publics hors abonnement, et même la marche. Le versement peut se faire en argent ou via titres-mobilité.
Sur le plan fiscal et social, le forfait mobilités durables séduit : il est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, dans la limite du plafond fixé. Le cumul avec la prime transport reste possible, tant que le total ne dépasse pas le seuil réglementaire. Certains dispositifs, en revanche, ne se combinent pas : impossible, par exemple, de profiter à la fois du forfait et du remboursement des frais de carburant pour le même trajet, ni de la déduction des frais réels sur l’impôt sur le revenu.
Ce cadre, issu de la loi d’orientation des mobilités, laisse une grande marge aux entreprises pour bâtir leur politique de mobilité durable tout en tirant parti d’un régime fiscal avantageux.
Quelles démarches suivre pour obtenir le forfait mobilités durables auprès de son employeur ?
L’activation du forfait mobilités durables au sein d’une entreprise commence par une base claire : soit un accord collectif, soit un accord de branche, soit encore une décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE. Montant, fréquence de versement, modes de transport couverts : tout est défini par la politique interne. Certaines structures désignent un référent mobilité pour guider les salariés et répondre à leurs questions.
Pour bénéficier de la prime mobilité, chaque salarié doit fournir la preuve de l’utilisation régulière d’un mode de transport durable. En pratique, l’employeur peut exiger une attestation sur l’honneur ou des documents concrets (tickets, factures, abonnements à une plateforme de covoiturage). Ce contrôle, généralement simplifié, reste indispensable pour sécuriser le versement et répondre aux éventuels contrôles Urssaf.
Une fois validé, le forfait peut être versé tous les mois, chaque trimestre ou une fois par an. L’entreprise doit renseigner ce versement dans la DSN (déclaration sociale nominative) et l’inscrire dans la BDESE (base de données économiques, sociales et environnementales). Cette traçabilité administrative permet de bénéficier des exonérations fiscales et sociales prévues et de respecter les obligations légales.
Le forfait mobilités durables s’impose, pas à pas, comme le carburant discret d’une nouvelle façon de concevoir les déplacements. Sous le regard des salariés comme des employeurs, il trace la voie d’une mobilité qui conjugue responsabilité, pragmatisme et avantage concret. La transition a déjà commencé, à chacun de choisir la prochaine étape du parcours.